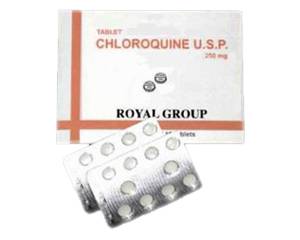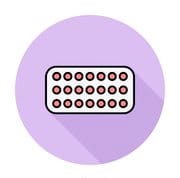La France est actuellement l’un des principaux foyers du coronavirus en Europe. Des mesures « barrières » relatives au virus sont décrétées pour limiter ses dégâts dont le port du masque de protection. Vis-à-vis de la crainte épidémique, les fabricants de masques respiratoires et les revendeurs ont du mal à faire face à la demande. Que faut-il savoir ?

Acheter une masque respiratoire réutilisable et lavable en ligne
Oxybreath Pro (Vainqueur du test)
- Masque lavable et réutilisable
- Comfortable a porter
- Nanotechnologie
Prix
- 1 x OxyBreath Pro 49 €
- 2 x OxyBreath Pro 69 € (35 € la pièce)
- 4 x OxyBreath Pro 123 € (31 € la pièce)
- 5 x OxyBreath Pro 135 € (27 € la pièce)
- Livraison gratuite
Qu’est-ce que le coronavirus ?
Le coronavirus tient son nom de sa forme : celle-ci ressemble à une couronne spécifique aux protéines qui l’enrobent. Il fait partie d’une vaste famille de virus qui infectent, soit différents animaux, soit l’homme. Ces virus peuvent provoquer un large éventail de maladies allant d’un rhume banal à une grave infection respiratoire. Ils peuvent être à l’origine d’épidémies mortelles comme celles du Sras, du Mers, et actuellement du Covid-19.
Le coronavirus se transmet non seulement de l’animal à l’homme, mais aussi d’homme à homme. Le Covid-19 qui touche actuellement toute la planète
Terre se transmet de différentes façons:
- Par les gouttelettes de salive projetée en éternuant ou en toussant
- Par des contacts étroits et prolongés qui favorisent la transmission
- Par un contact à moins de 1 mètre du malade
- Par le contact des mains avec des surfaces infectées, puis avec le nez, les yeux ou la bouche
- Par l’absence de mesures de protection efficaces
À l’échelle planétaire, des mesures dites « barrières » sont préconisées pour limiter l’impact du virus:
- Se laver fréquemment les mains avec du savon, si possible, le faire avec un gel hydro alcoolique
- Tousser et éternuer dans son coude
- Utiliser des mouchoirs à usage unique
- Éviter de se serrer la main
- Éviter de faire la bise pour se dire bonjour ou au revoir
- Porter un masque respiratoire
Comment un masque respiratoire peut-il aider à diminuer la diffusion du coronavirus ?
Depuis l’apparition du Covid-19 en Chine en décembre 2019, de nombreux Chinois portent des masques respiratoires. Puis, le port du masque a été rendu obligatoire dans les espaces publics. Beaucoup d’habitants ont ensuite décidé par eux-mêmes d’en porter un, ce qui a été suivi par les populations des autres pays concernés, dont la France.
Les études menées par les scientifiques ont prouvé que le coronavirus est un virus respiratoire. Ce qui laisse imaginer qu’il se transmet entre humains par le biais de sécrétions telles que les postillons ou les gouttelettes de salive en cas de toux ou d’éternuements. Le port d’un masque respiratoire est recommandé à une personne malade afin d’éviter qu’elle ne transmette l’infection aux autres. Mais il est également porté par les personnes qui ne sont pas malades en prévention, pour ne pas être contaminées par le virus.
Que faut-il rechercher lors du choix d’un masque respiratoire ?
Le principal critère de choix d’un masque respiratoire est sa capacité à filtrer. Le masque doit être parfaitement positionné, complètement étanche en vue de ne pas laisser passer le virus. Les masques appelés « masques de protection respiratoire individuelle », de type FFP pour Filtering Facepiece Particles, sont même équipés d’un dispositif de filtration pour se prémunir d’une contamination venue de l’extérieur. Ils se déclinent en plusieurs types hiérarchisés, selon le degré de filtration :
- Le FFP1 est censé filtrer 78% des particules
- Le FFP2 est censé filtrer 92% des particules
- Le FFP3 est censé filtrer 98% des particules
Les masques FFP2, communément appelés « masques bec de canard », restent la protection de référence en cas d’épidémie. Ceux-ci sont préconisés pour les personnes qui courent un risque majeur d’exposition. C’est le cas, par exemple, des professionnels de santé qui sont en contact avec les malades. Ce type de masques est plus sophistiqué et plus efficace que les masques chirurgicaux dits masques 3 plis. Ces derniers sont surtout destinés aux personnes malades ou qui présentent des symptômes pour éviter qu’elles ne contaminent leur entourage. Les masques sont en général jetables, mais il existe également des masques lavables et réutilisables.
Quels sont les avantages d’un masque respiratoire lavable et réutilisable ?
Depuis le début de l’épidémie, en pleine psychose, le prix des masques respiratoires s’est envolé, allant parfois jusqu’au triple.
Le premier avantage d’un masque respiratoire lavable et réutilisable est donc la possibilité de faire moins de dépenses. Le deuxième avantage est l’assurance d’avoir son masque respiratoire à disposition malgré une éventuelle rupture de stock et d’approvisionnement. Cette éventualité est d’autant plus à craindre que la Chine, qui est le principal producteur de masques au monde, se trouve être l’épicentre de l’épidémie.
Les masques FFP2 réutilisables offrent le niveau de protection le plus indiqué contre le coronavirus. Ils épousent parfaitement la forme du visage, l’ensemble de l’air sera ainsi bien filtré.
Les masques 3M sont aussi une référence sur le marché des masques de protection respiratoire réutilisables. Ce sont ceux présentant un excellent rapport qualité/prix : ils sont efficaces et solides et proposés à un prix restant accessible.